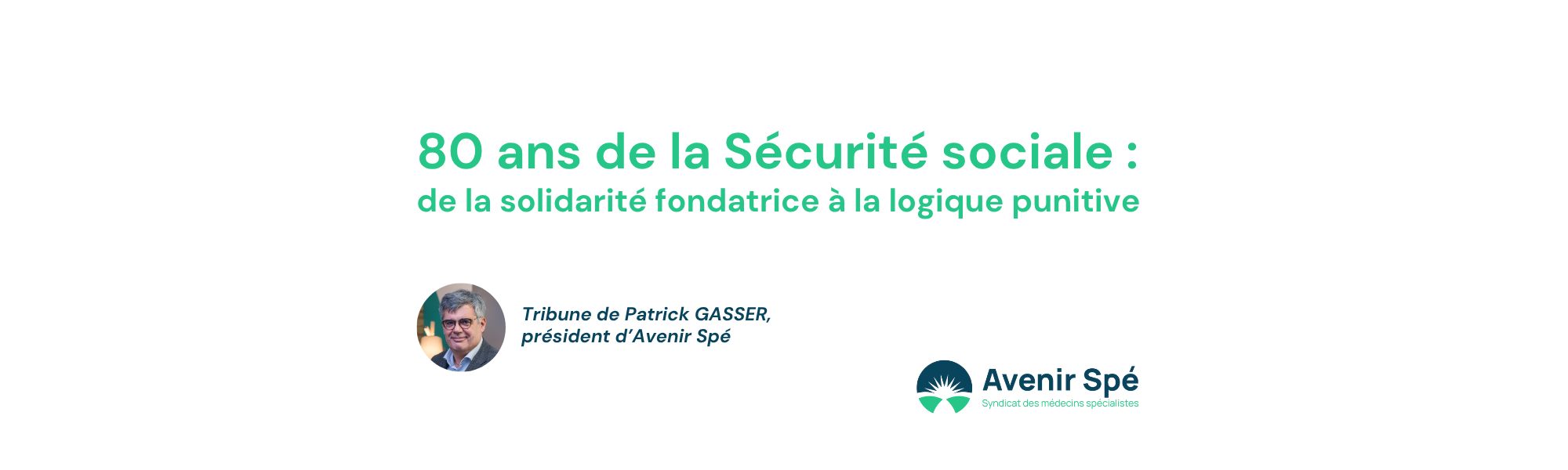Alors que la Sécurité sociale célèbre ses 80 ans, le contraste est saisissant entre l’esprit de 1945 — celui d’une solidarité confiante et émancipatrice — et la réalité actuelle d’un système centré sur le contrôle, la contrainte et l’urgence budgétaire. Face à un déficit abyssal, à l’épuisement des acteurs et à l’irruption des géants du numérique dans le champ de la santé, il est urgent de refonder notre modèle autour d’une triple exigence : responsabilité, innovation et humanité.
Un anniversaire sans vision
L’ordonnance du 4 octobre 1945, portée par Ambroise Croizat et Pierre Laroque, avait posé les fondations d’un pacte social inédit : garantir à chacun la sécurité du lendemain. Dans une France ruinée, on fit le choix de la solidarité, de la dignité et du dialogue social.
Aujourd’hui, le constat est amer : pour ses 80 ans, la Sécurité sociale voit balayées toutes les ambitions que ses parents avaient mises en elle. Les mesures d’économies se succèdent tous azimuts, sans projet, sans vision, sans objectif d’amélioration de la santé des Français. Seule compte l’urgence budgétaire. Les pleins pouvoirs sont confiés à la technocratie, privant patients et acteurs de toute visibilité, et plongeant notre système de santé dans un brouillard si dense qu’il déboussole jusqu’aux idées les plus nobles.
Un ONDAM insincère, symptôme d’une crise de confiance
Pour 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), fixé à +0,9 %, atteint un niveau de faiblesse jamais observé depuis la création de la Sécurité sociale. Ce chiffre, à lui seul, dit tout de la gravité de la situation. Chacun le sait — responsables politiques, Assurance maladie, professionnels de santé : un tel niveau est intenable. L’évolution démographique, la hausse des affections de longue durée, l’inflation médicale et le coût croissant des traitements innovants rendent cet objectif aussi irréaliste économiquement que socialement dangereux. Ce n’est pas un ajustement, c’est un déni. Cette insincérité budgétaire, récurrente et dénoncée depuis des années par la Cour des comptes et tous les organismes de prévision, mine la crédibilité de la parole publique.
Dans ces conditions, comment les professionnels de santé pourraient-ils encore accorder leur confiance aux pouvoirs publics ? Et se montrer responsables, innovants et solidaires quand l’État lui-même s’autorise à construire ses budgets sur des hypothèses intenables ? Ce décalage permanent entre annonces et réalités nourrit un mal plus profond : la défiance démocratique. La santé, autrefois ciment de la cohésion nationale, devient terre de désillusions. La promesse républicaine s’effrite.
Déjà, les revalorisations tarifaires promises pour juillet 2025 n’ont pas été tenues. Les économies annoncées sur l’imagerie médicale et l’accusation de « rentiers » pour certaines spécialités viennent aggraver ce sentiment d’injustice et d’incompréhension. Elles sonnent comme un mauvais signal adressé à l’ensemble de la médecine libérale, pourtant appelée à être un pilier de la refondation du système de santé.
Comment mettre en œuvre la qualité, l’efficience, l’expertise et la pertinence que prônent les ministres, quand la politique budgétaire pénalise précisément ceux qui les incarnent ?
Les conséquences sont évidentes : les patients seront les premiers à en souffrir, d’autant que les franchises et participations forfaitaires augmenteront encore en 2026.
Entre intelligence artificielle et risque de dépossession
L’autre défi majeur est celui de la transformation numérique. L’intelligence artificielle, les données de santé et les outils d’aide à la décision ouvrent à la fois des perspectives extraordinaires et des risques réels. Si la puissance publique ne redonne pas souffle et sens à la Sécurité sociale, d’autres le feront à sa place. Déjà, les géants du numérique — Amazon, Microsoft, Google — investissent massivement dans la santé, la donnée médicale et les services prédictifs. Le risque est grand de voir émerger une « HealthTech » privée, où les algorithmes et les plateformes remplaceraient progressivement les principes de solidarité, de souveraineté et d’équité. L’esprit de 1945 ne survivra pas à ce transfert silencieux si nous n’affirmons pas, dès aujourd’hui, la primauté du service public et de la responsabilité collective dans le pilotage du système de santé.
Responsabilité partagée et audace collective
Pour autant, refuser cette logique punitive ne signifie pas ignorer la réalité : la dette sociale est abyssale, et la soutenabilité du modèle mise en danger. Nous ne pourrons pas financer éternellement toutes les innovations thérapeutiques sans une réflexion sur les usages et les priorités. Il faut donc une responsabilité collective et individuelle.
Responsabilité des professionnels, d’abord, pour repenser les organisations et garantir l’efficience et la pertinence du soin.
Responsabilité des usagers, ensuite, pour les impliquer davantage dans la prévention et le bon usage des ressources.
Responsabilité politique, enfin, pour redonner un cap : la santé ne peut être gérée comme une dépense, elle doit être pensée comme ce qu’elle est : un investissement humain et social. Les réflexions de nombre d’acteurs du système regorgent d’idées concrètes. Ce dont nous manquons, ce n’est pas d’analyses, mais de courage collectif.
Sortons donc de la logique du rabot pour engager une trajectoire de financement responsable et partagée. Oui à la maitrise des finances publiques, mais pas au prix de la dégradation de la qualité et de l’équité d’accès aux soins. Car ce n’est pas la dette de la Sécurité Sociale qui la met en péril, mais l’absence de cap.
C’est pourquoi la célébration de ses 80 ans, loin de l’exercice de nostalgie, se doit d’être un acte politique de lucidité et de courage. Avec une promesse à tenir : celle d’une société qui refuse de choisir entre efficacité et humanité, entre innovation et justice sociale.
Retrouvez également cette tribune sur le site du journal des Echos : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/80-ans-de-la-securite-sociale-on-est-passe-de-la-solidarite-fondatrice-a-la-logique-punitive-2194481